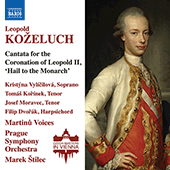Nous avions évoqué l'opéra de Wagner dans un précédent article, annonçant, avec impatience déjà, la recension de Jean Lacroix qui assistait hier à la représentation de LOHENGRIN. Voici ce texte dont nous indiquons en exergue une des appréciations et que nous nous réjouissons de partager avec les lecteurs de LIVRaisons. Jean Jauniaux
Lohengrin à la Monnaie,
un
exaltant débat musical et politique
par Jean Lacroix
Il faut bien le
reconnaître : Richard Wagner, ce compositeur si exaltant, si enchanteur,
cet auteur de livrets remarquables (ceux de ses opéras !), est aussi un
écrivain dont les ouvrages à portée antisémite sont détestables, voire
impardonnables. On a beau tenter toutes les explications, les replacer dans un
contexte biographique ou historique qui les éclairerait pour leur donner un
semblant de respectabilité, ils demeurent une tache indélébile sur ce magicien
de la musique, dont l’impact, on le sait, est plus qu’immense. Bayreuth est un
temple depuis bientôt près de 150 ans, un temple dont la sacralisation est
quasi intouchable. Le nazisme, et Hitler le premier, a saisi très vite tous les
avantages qu’il y aurait à s’approprier l’héritage wagnérien, ce qui lui fut
d’ailleurs facilité par l’amour aveugle que lui portèrent certains membres de
la famille, en particulier la belle-fille de Wagner, Winifred, qui ne démentira
jamais ses convictions et son attachement indissolubles au Führer. Tout cela a
fait couler beaucoup d’encre (1), la littérature à ce sujet est prolifique et
révélatrice du malaise, provoqué par l’influence directe ou indirecte
qu’auraient pu avoir les textes de Wagner sur la légitimation future du IIIe
Reich et ses abominables excès.
En inscrivant à l’affiche de la
présente saison un ambitieux Lohengrin,
attendu avec impatience, la Monnaie a décidé d’en confier la mise en scène à
Olivier Py. Celui-ci plonge au cœur de la question : y avait-il dans le
romantisme allemand les germes du national-socialisme ? Le metteur en
scène signe dans le passionnant programme un long développement à ce propos
(soulignons la qualité de ces programmes, qui sont souvent des études de haut
niveau). Il fait même une démarche complémentaire : avant le lever du
rideau, il se présente au public, avec une modestie touchante, pour une brève
synthèse du message qu’il veut transmettre. Elle tient en peu de mots, en
réalité, et nous la résumons lapidairement : « Lohengrin, qui raconte l’attente et l’échec, n’est pas une pièce
nationaliste, mais une pièce sur le nationalisme. » Les phrases glaçantes,
en forme de coup de poing, que prononce le roi Henri l’Oiseleur au début du
premier acte, sont tranchantes : le souhait d’une Allemagne unifiée dans
un état vainqueur. Lorsqu’il dit : « L’heure est venue de sauver
l’honneur de l’empire à l’est comme à l’ouest, que tous
m’entendent », il y a de quoi mesurer les conséquences envisageables.
Lohengrin est donc une pièce politique, il s’agit bien de théâtre
au-delà du chant et de la musique sublimes, et c’est là qu’Olivier Py veut
installer le symbolisme de sa démarche. Le lever de rideau est
impressionnant : on est face à un immense bâtiment qui occupe tout l’espace,
un bâtiment défiguré, déchiqueté, aux murs calcinés, orné de niches dans
lesquelles évolueront la plupart du temps les choristes. Installé sur un
plateau tournant, ce symbole omniprésent du désastre servira de
« paysage » à toute l’action. Nous sommes en l’« année
zéro », dans les ruines de Berlin, en 1945 ; chacun ressent la
tragédie de l’époque. Au fil du spectacle, elle sera renforcée par des scènes
qui interpellent, parfois glauques, souvent significatives, toujours étranges.
Des scènes que nous rapportons pêle-mêle, sans pouvoir les citer toutes :
des trappes dans le sol d’où sortent des personnages, des seaux (de débris de
pierrailles), portés avec difficulté par des femmes et qui passent de main en
main sur toute la longueur du plateau, un défilé de personnages qui déposent
leurs valises en les abandonnant pour partir sans équivoque vers leur sombre
destin…
Mais aussi des dessins esquissés,
des clairs de lunes ou des montagnes à la Caspar David Friedrich, des écritures
de poèmes, dont des extraits de la poignante Fugue de mort, de Paul Celan, écrite en 1945, qui crie
notamment : « […] Un homme habite la maison qui joue avec les
serpents qui écrit / qui écrit quand il fait sombre sur l’ Allemagne tes
cheveux d’or Margarete […] (traduction d’Olivier Favier) ». Cela, c’est au
début du troisième acte, pendant le prélude musical. Juste après, le plateau
montre neuf niches (accusatrices ? ou en questionnement ?) dans
lesquelles on retrouve Goethe (sur un socle, mise en évidence qui interroge),
Grimm, Novalis, Schlegel, Hegel, Hölderlin, Caspar Friedrich ou Carl Maria von
Weber, mais aussi une tête échevelée de Beethoven et un cygne. C’est dans ces
« cases » que le drame final se dénouera : Elsa demande à son
mari auquel elle a promis de ne pas lui demander son nom de le lui révéler
malgré tout, Telramund tente d’assassiner Lohengrin qui le tue, Lohengrin
annonce qu’il va révéler sa véritable identité, avec toutes les conséquences
qui vont en découler. On considérera ici le synopsis connu par le lecteur pour
ne pas alourdir le propos.
Il y a aussi des coups de génie,
le plus brillant étant le jugement de Dieu qui doit affronter Lohengrin à
Telramund à l’acte I pour confirmer ou non l’innocence d’Elsa : c’est en
fait une partie d’échec, agrémentée, si l’on peut dire, par une bagarre entre
figurants. Aussi brillant coup de génie sera le moment où Lohengrin annonce
qu’il est le fils de Parsifal et évoque le Graal : le chanteur est seul en
scène, son ombre immense et son jeu de mains avec des couronnes qu’il abandonne
l’une après l’autre donnent à son aveu une dimension sacrée qui le dépasse.
Quant au petit prince disparu, que le spectateur a vu de temps à autre au cours
de l’action en costume blanc, image de l’innocence, mais aussi occupé à jouer
avec un cintre qui lui sert d’arme factice ou avec de petits bombardiers, il
est retrouvé mort, tué par Ortrud, au moment où Lohengrin part définitivement,
laissant son épouse Elsa inanimée et tout le monde dans le malheur. Les
allusions au fameux cygne, qui avait tellement fasciné en son temps le roi
Louis II de Bavière, sont esquissées, de façon imaginaire, par un doux amas de
plumes que Lohengrin laisse s’effilocher entre les doigts. L’instant est si
fort qu’il prend à la gorge.
On l’aura compris : cette
production de Lohengrin est
extraordinaire, car elle est au-delà du symbole, elle est impressionnante, elle
se veut d’une lisibilité absolue, ce à quoi la dimension théâtrale, cohérente
et millimétrée, rend justice. La direction d’acteurs est d’une implacable et
absolue rigueur. L’hommage que nous adressons à Olivier Py va aussi au
décorateur, Pierre-André Weitz ; ils sont indissociables. Il faut donc
saluer cette vision qui hantera longtemps les mémoires des mélomanes, car elle
allie la noirceur du drame à l’évidence de l’écriture musicale. Olivier Py
s’affronte à Wagner, dont la musique est à ce point sublime qu’elle risque de
faire tout oublier, jusqu’à l’impardonnable. C’est là que réside le vrai danger
wagnérien. Comme l’a si bien écrit Vladimir Jankélévitch (2) : « Il y
a dans la musique une double complication, génératrice de problèmes
métaphysiques et de problèmes moraux, et bien faite pour entretenir notre
perplexité. Car la musique est à la fois expressive et inexpressive,
sérieuse et frivole, profonde et superficielle ; elle a un sens, et n’a
pas de sens. » C’est peut-être André Tubeuf qui a trouvé la formule applicable
à cet opéra si romantique et si actuel à la fois : « En le
Hollandais, en Tannhäuser, en Sachs plus tard, Wagner s’incarne biographiquement.
En Lohengrin, comme en Tristan, il se représente,
événement européen (comme Nietzsche disait de Goethe) – mythe. » (3).
S’affronter à Wagner, c’est faire face au mythe. Olivier Py a relevé le défi,
reste à savoir s’il l’a gagné.
Il est temps d’aborder l’interprétation
musicale, précisément. Le plateau vocal est d’une rare perfection, en ce
dimanche 29 avril ; il est vrai qu’il est rodé : c’est la quatrième
représentation en ce qui le concerne (il y a une seconde distribution, où l’on
retrouve Gabor Bretz et Werner Van Mechelen, mais pas les autres
protagonistes). Le ténor américain Eric Cutler, que l’on avait déjà pu
apprécier dans la production des Huguenots
de Meyerbeer en 2011 (mise en scène d’Olivier Py, déjà), incarne Lohengrin
avec puissance et éclat, il est véritablement habité par le rôle. Le récit du
Graal, au troisième acte, lorsqu’il révèle son identité, est bouleversant, car
il associe une intense lumière intérieure à ce récit mystique qui provoque chez
l’auditeur une émotion qui le mène au bord des larmes. L’Elsa de la soprano
suédoise Ingela Brimberg, qui fait ses débuts dans le rôle (mais pas à la
Monnaie : elle faisait aussi partie des Huguenots de 2011), se révèle elle aussi puissante - les voix passent la rampe avec netteté, ce
qui n’est pas évident dans le processus wagnérien -, avec des accents portés
par une fragilité poétique. Quant à l’Ortrud d’Elena Pankratova, que l’on
entend pour la première fois à la Monnaie (gageons qu’on l’y reverra, vu la
tornade finale d’applaudissements qui a salué sa prestation), elle a déjà été
Kundry à Bayreuth et Vénus à Dresde. Ici, la soprano russe, dans cet emploi
malfaisant, use d’une intonation affirmée, accompagnée de nuances amples et
souples à la fois. On pense à une Lady Macbeth, entraînant son époux Telramund,
fatalement écrasé (le baryton-basse britannique Andrew Foster-Williams, au
phrasé très clair), vers son tragique destin. Le roi Henri, qui assiste navré à
toutes les péripéties du drame et tente vainement de jouer au conciliateur, est
impressionnant. Longiligne, digne, la basse hongroise Gabor Bretz fait preuve
dans ce rôle, d’un timbre équilibré. Il y fait ses débuts et aussi à la
Monnaie, une vraie réussite. Ce que l’on peut dire tout autant de Werner Van
Mechelen, qui a été, on le sait, lauréat de la première édition du Reine
Elisabeth de Chant. Notre baryton-basse belge interprète régulièrement des
personnages wagnériens, et cela se sent. Il est à l’aise dans la peau du
Heerrufer, le Héraut qui est le lien narratif de l’action. Son impeccable jeu
d’acteur est à souligner, comme l’intensité d’une voix maîtrisée. Il faut
préciser que Bretz et Van Mechelen sont de toutes les distributions, dix au
total. Chapeau bas…
Chapeau bas aussi aux chœurs
préparés avec le plus grand soin par Martino Faggiani. On sait à quel point la
présence des chœurs est fondamentale chez Wagner. Puissants et subtils dans le
même temps et le même espace, ils sont au centre de l’action ; ils donnent
des frissons par leur investissement, portés vers l’apogée par un orchestre
dans une forme idéale, un orchestre que l’on a rarement entendu aussi homogène,
aussi engagé, aussi inspiré. En choisissant Alain Altinoglu pour diriger une
série de productions de la Monnaie, Peter de Caluwe a sans doute réussi un des
plus parfaits défis de sa carrière. Né à Paris en 1975, ce chef prestigieux est
une « bête de fosse », dans le sens le plus noble du terme ; il
a déjà dirigé Lohengrin à Bayreuth en
2015. Il est complice de son orchestre, il est magistral quand il le faut, mais
aussi clair, raffiné, sensible, émouvant par sa participation à chaque détail
(son visage révèle à quel point il est « dans » la musique). Il
galvanise le plateau entier, musiciens, chanteurs, choristes avec la foi qui
transporte les montagnes. Les wagnériens purs se seront régalés de cette vision
que nous qualifierons, en ce qui nous concerne, de parfaite. Le Prélude de
l’acte I est empreint de poésie et de lyrisme, dans un tissu presque
chambriste, avant d’embrasser un univers sonore où le grandiose le dispute à la
lumière. Rien n’est minimisé, rien n’est exacerbé, car l’équilibre domine.
Altinoglu sait que c’est un plateau entier qu’il doit porter. La réussite est
totale, les scènes finales de chaque acte s’achèvent dans une tension musicale,
dramatique et théâtrale que l’on ne peut que qualifier d’ascendantes jusqu’à
l’exaltation. Une production à marquer non d’une seule, mais de multiples
pierres blanches.
Jean
Lacroix, le 30 avril 2018
(1) Nous
avons nous-même tenté l’expérience en 2013 dans un Wagner. Journal de Bayreuth, paru aux Editions de la Page.
(2) Vladimir
Jankélévitch : La Musique et
l’Ineffable, Paris, Seuil, 1983, p. 5.
(3) André
Tubeuf : L’Offrande musicale,
Paris, Laffont/Bouquins, 2007, p. 564.